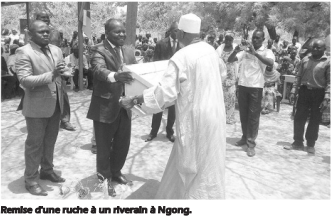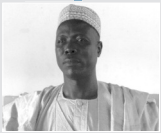Après son lancement le 03 janvier 2023, les membres du Comité de pilotage du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone (Viva-Logone) se sont réunis le 27 novembre dernier à Yaoundé, dans le cadre des 5ème et 6ème sessions de ce Comité de pilotage (Copil). Ces assises ont donné l’occasion d’examiner l’état d’avancement global des activités du projet, d’évaluer le niveau de mise en œuvre du plan de travail et du budget 2024, et d’examiner d’autres documents liés à l’amélioration de la gouvernance et de la performance du projet.
Les travaux ont été présidés par le secrétaire général du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat). JeanTchoffo s’est avant tout félicité de la présence à ses côtés du gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakary, du président du Conseil régional de l’Extrême-Nord, Daniel Kalbassou, et du directeur général de la Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (Semry), Fissou Kouma. En ouvrant ces travaux, le secrétaire général du Minepat a salué la performance à mi-parcours du projet Viva-Logone, d’autant plus que le projet affiche un taux d’exécution physique et financière respectivement de 27 % et 24,2 % à ce jour. De la présentation du rapport d’activités du projet, l’on apprend que, depuis sa mise en vigueur, «des contrats d’assistants techniques ont été élaborés et conclus. C’est ainsi que les bureaux d’études Mazars pour l’accompagnement du plan de restructuration de la Semry et Setico pour l’accompagnement du processus de transfert de la gestion des périmètres irrigués aux associations d’usagers d’eau ont été mobilisés», fait savoir Jean Tchoffo. Ainsi, les 5ème et 6ème sessions du Copil du Viva-Logone avaient donc entre autres ambitions de passer en revue les activités à mener en 2024, mais pas seulement.
Plan de travail 2025
Les grandes lignes de la préparation du plan de travail et du budget annuel 2025 du Copil de Viva-Logone donnent plusieurs indications. D’abord, il est prévu, au cours de l’exercice concerné, «le développement et la réhabilitation de l’irrigation avec un transfert progressif de l’exploitation et de l’entretien des périmètres irrigués aux associations d’irrigation, le transfert des services de labour au secteur privé, l’implication effective du secteur privé pour la promotion des chaînes de valeur agricoles (riz), et la révision du rôle régalien du gouvernement, en particulier des organismes tels que la Semry», explique le coordonnateur du projet Viva-Logone. Laoumoya Merhoye laisse également entendre que ce projet a pour but de faire en sorte que les producteurs doublent leur production. «Le projet entend aider les producteurs à payer les redevances sur les instants à hauteur de 50 % et les redevances hydrauliques à hauteur de 75 % pendant deux campagnes par an. L’objectif final est de faire en sorte que si le producteur gagnait 50 000 FCFA depuis 30 ans, ce projet puisse doubler ses revenus à 100 000 FCFA», soutient-il. Une vision également partagée par le représentant des jeunes bénéficiaires de Viva-Logone : «Nous avons déjà suivi plusieurs formations, notamment en gestion de l’eau. L’État voulait une même production dans une même parcelle, ce qui était autrefois difficile à réaliser. Toutefois, le projet Viva-Logone, grâce à son appui technique et financier, pourra nous permettre d’arriver à produire deux fois plus de quantité sur une même parcelle», affirme Peter Ngaranga, représentant de l’association des usagers de l’eau.
Il convient de rappeler que le projet Viva-Logone vise spécifiquement à soutenir la sécurité hydrique régionale et la gouvernance des ressources en eau, principalement à travers la réhabilitation des infrastructures d’irrigation et de drainage et l’appui aux associations d’usagers de l’eau, à promouvoir la production agricole et agroalimentaire, et à mettre en œuvre un plan de transformation de la Semry tout en renforçant les services publics. Financé par la Banque mondiale, il va aider à la mise en œuvre de la politique d’import-substitution dans la chaîne riz.
Par Régis Belinga