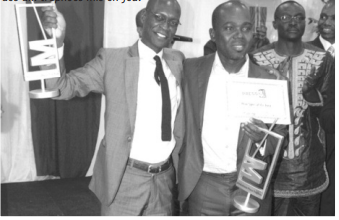Yaoundé : Le chemin de croix des déplacés internes de Boko Haram
Depuis que Boko Haram a entamé des exactions contre les populations civiles, plusieurs familles ont fui leurs villes et villages. Ces déplacés internes peinent à acquérir des espaces vitaux pour mener leurs activités dans la ville de Yaoundé. Malgré les efforts du gouvernement camerounais à trouver un statut pour les déplacés internes, ces couches sociales sont restées en marge des différentes aides et appuis institutionnels.

En ce moment, nous devons trois mois d’arriérés de loyer, soit 40 000 Fcfa par mois que nous devons payer au bailleur pour les deux chambres. Nous n’avons personne sur qui compter pour trouver cet argent, à part nos petits boulots».
C’est le témoignage d’un déplacé interne qui s’est réfugié dans la ville de Yaoundé. Le chef de cette famille constituée de six personnes, originaire de la région de l’Extrême-Nord, a tout abandonné depuis plus de cinq ans à cause des exactions de Boko Haram. Depuis qu’il est dans la capitale politique du Cameroun, ce déplacé interne remet en question l’efficacité de l’aide humanitaire octroyée aux victimes de la secte qui sévit dans la région de l’Extrême-Nord.
Comme lui, beaucoup d’autres victimes des exactions de Boko Haram ont quitté leur septentrion natal pour migrer vers les grandes métropoles du pays, pour se mettre à l’abri des extrémistes, mais aussi à la recherche d’un espace plus sûr, afin de mener leurs activités. Mais plusieurs d’entre eux font face à divers problèmes qui rendent leur quotidien difficile dans la ville de Yaoundé. Toukouda Bouba est de ceux-là. Il vient du département du Mayo-Sava, dans la région de l’Extrême-Nord, l’une des localités longtemps assiégées par les militants de la secte islamiste Boko Haram. Non seulement, il ne peut pas revenir chez lui, mais il déplore le manque d’accompagnement dont lui et sa famille auraient été victimes : «les premiers mois dans la ville de Yaoundé n’ont pas été évidents pour ma famille et moi. Nous nous sommes énormément battus pour obtenir un abri. Au départ, nous n’avons reçu de l’aide de personne. Il arrivait parfois certains moments où on allait au centre-ville pour mendier jusqu’à ce qu’on obtienne un peu d’argent pour acheter un repas», confie-t-il.
Malgré les difficultés que vivent les déplacés, une lueur d’espoir se dessine toutefois pour certains. Bouba et sa famille ont finalement été recueillis par une communauté des ressortissants de la région de l’Extrême-Nord qui résident au quartier Madagascar. Ils ont construit un petit abri en tôle dans lequel ils vivent désormais. Un abri qui reste provisoire. Mais qui permet au père de famille de se souvenir des conditions horribles dans lesquelles il a réussi à sauver sa vie. «Nous avons couru dans la brousse après que des avions de l’armée de l’air ont lancé des raids sur notre village pour débusquer les militants de Boko Haram», se rappelle-t-il. Et de poursuivre : «nous avons passé six mois dans la forêt. Les insurgés ont capturé et tué certains enfants. Quand j’ai réussi à m’échapper, je suis resté dans un camp de réfugiés. Mais la vie n’y était pas satisfaisante. Alors je suis venu ici».
Résilience
Quand manger devient un défi quotidien, les déplacés internes sont prêts à pratiquer n’importe quelle activité pouvant leur permettre de survivre. Pour s’adapter à la situation, certains ont opté pour des activités qui ne nécessitent pas un investissement financier préalable. C’est le cas d’Awa qui offre désormais ses prestations dans les tâches domestiques parce que non seulement, elle n’a pu rien emporter comme biens dans sa fuite, mais surtout, elle n’a plus la possibilité d’acquérir des espaces pour cultiver comme elle le faisait. «Je suis ménagère chez une dame de la place. Autrefois, j’étais cultivatrice. J’avais de grands champs qui me permettaient de récolter de bonnes moissons à la fin de saison. Tout ça, c’était jusqu’à ce jour où Boko Haram a attaqué mon village à Sékandé dans l’Extrême-Nord. Nous avons été contraints de fuir, ma famille et moi», raconte-t-elle.
D’un autre côté, ces activités domestiques sont pour certaines d’entre elles un tremplin vers une activité meilleure. Question d’accumuler des bénéfices afin de lancer leurs propres affaires. Mariam Didja en est un parfait exemple. Elle a travaillé pendant deux ans dans un domicile privé où elle percevait 40 000 Fcfa le mois. De ce revenu, la jeune dame a pu épargner 400 000 Fcfa pendant deux ans, ce qui lui a permis de mettre fin à ses activités domestiques qui devenaient contraignantes au fil du temps, pour devenir commerçante.
Par ailleurs, les réalités de la ville de Yaoundé conditionnent ces couches vulnérables à ne louper aucune occasion. Les immeubles en chantier sont non seulement des nids d’opportunités pour ces chercheurs d’emplois malgré le revenu quasi-insignifiant, mais aussi, des lieux de résidence pour ces sans abris.
La manne du ciel, solidarité oblige
Fort de ce constat, quelques actions ont été entreprises à travers les confessions religieuses, la société civile et les pouvoirs étatiques, à l’effet de faciliter l’insertion socio-professionnelle de ces déplacés dans la ville de Yaoundé. A titre d’illustration, la province ecclésiastique de Garoua résidant à Yaoundé, une jeune association chrétienne, a lancé le 15 avril 2023 une opération qui a consisté en une collecte de fonds, à l’occasion d’une messe d’action de grâce pour soutenir les sinistrés et les personnes qui ont fui les exactions de Boko Haram pour s’installer à Yaoundé. La levée de fonds qui a vu la présence des évêques de la province ecclésiastique de Garoua, a permis de mobiliser une importante somme d’argent. Ces fonds serviront à soutenir les déplacés internes et les victimes des catastrophes naturelles et à renforcer leur résilience. «Il est précisément question d’améliorer la situation sanitaire des personnes défavorisées, ainsi que leur accès aux opportunités économiques et une alimentation adéquate», explique Laurent Couga, président de la province ecclésiastique de Garoua résidant à Yaoundé.
Dans le même élan, l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM) a intensifié les opérations pour répondre aux besoins des populations déplacées, en centrant son action sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les zones de conflits sur les thèmes comme la dépression, le stress post-traumatique, les stratégies positives d’adaptation et de gestion du stress, l’importance du soutien moral entre autres.
Efforts des pouvoirs publics
De son côté, le ministère des Affaires sociales (Minas), chargé de la mise en œuvre des politiques du gouvernement en matière de protection, d’assistance des personnes socialement vulnérables, a également initié des actions sur les plans stratégique et opérationnel, en faveur des déplacés internes. Au niveau stratégique, le Minas a mis en place des outils de prise en charge psychosociale des personnes déplacées internes dont un plan d’accompagnement social, lequel recense et oriente la prise en charge de ces cibles à besoins spécifiques. A côté de cela, l’Etat a élaboré un guide de prise en charge psychosociale destiné aux travailleurs et intervenants sociaux. Cet outil permet aux agents du ministère d’identifier les services sollicités par ces personnes vulnérables afin de faire des plaidoyers auprès des institutions pour les aider à trouver une assistance.
Dans le cadre de la décentralisation, le gouvernement alloue également des fonds aux collectivités territoriales décentralisées, en vue de l’accompagnement de ces couches défavorisées. Seul bémol, les collectivités n’appliquent pas toujours les instructions dictées dans leur cahier de charges. «En 2022, le Minas a financé une dizaine de projets des déplacés internes dont la plupart d’entre eux ont été recensés dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie (ouverture d’atelier de couture, salon de coiffure), etc.», selon un haut cadre du Minas.
Une volonté limitée
Toutefois, malgré la volonté étatique d’allouer des fonds pour la prise en charge de ces déplacés internes, ceux-ci restent néanmoins insignifiants avec la demande qui ne cesse d’accroitre. «Nous sommes confrontés à un problème d’insuffisance de financements. On espère qu’au fil des années ça va s’améliorer», souligne la même source.
Les problèmes sécuritaires dans la région de l’Extrême-Nord ont contraint à quitter leurs terres, 573 187 individus parmi lesquels 385 372 déplacés internes, 49 660 réfugiés hors camp et 138 152 personnes retournées. Nonobstant les efforts des offices religieux, la société civile et les pouvoirs étatiques, la plupart d’entre eux fait toujours face aux problèmes de logements, d’accès aux soins de santé, à l’éducation, et à l’emploi.
Par Régis Belinga